 MORY
KANTE ARTISTE
MORY
KANTE ARTISTE
"Mon destin de griot est de voyager"
Après
le retentissant succès de son "Yéké Yéké",
Mory Kanté a eu du mal se maintenir dans ce rôle de méga
star de la world music. Mais, il y a deux ans (2001) il a fait un
retour fracassant avec un tube aux sonorités plus variées
: "Tamala" ou le "Voyageur". Un album qui scelle
presque le destin de voyageur qu'il est avant tout. Un excellent opus
qui actuellement distribué au mali grâce aux bons soins
de Mali K7.
C'est
en plein Empire Mandingue dans un petit village du sud de la Guinée,
Albadaria, près de Kissidougou, que naît Mory
Kanté le 24 février 1950. Son père, El
Hadj Djelifodé Kanté, est déjà un très
vieil homme à la naissance de Mory, qui compte parmi les plus
jeunes de ses 38 enfants. La famille Kanté est une célèbre
famille de griots, sortes de
poètes, chanteurs, historiens et journalistes à la fois.
En tout cas de véritables mémoires vivantes dont le
rôle est, depuis la nuit des temps, de conter en musique les
épopées sans fins des familles et des peuples. Les parents
de Mory sont tous les deux griots, fonction héréditaire,
et son grand-père maternel était un puissant chef de
griots à la tête
d'un puissant clan. Le destin de l'enfant est donc tout naturellement
de devenir un "jali",
terme mandingue pour "griot".
Elevé
d'abord par sa mère malienne Fatouma Kamissoko, Mory va à
l'école française. A 7 ans, sa famille l'envoie à
Bamako, capitale du Mali, chez sa tante, Mananba Kamissoko, autre
célèbre griotte.
Jusqu'à 15 ans environ, il est initié aux rituels traditionnels,
au chant et au balafon. Il participe à de nombreuses fêtes
familiales, à des cérémonies officielles au cours
desquelles il se forge une expérience solide de musicien et
de chanteur. Au cours des années 60, la toute jeune République
du Mali, reçoit de nombreuses influences musicales : rumba
zaïroise, salsa cubaine, pop et rock anglo-saxons. Le jeune Mory
se passionne très vite pour ces nouvelles musiques électrifiées
et apprend la guitare. Fort d'une très riche expérience
traditionnelle, il se tourne vers une certaine modernité très
éloignée de son cadre familial. En 1968, il quitte l'école
pour intégrer l'Institut des Arts de Bamako. Mais dès
1969, il cesse sa formation et joue dans différents orchestres.
Il se forge une première notoriété en faisant
danser les Maliens des nuits entières dans des bals à
ciel ouvert. On était au temps des "apollos" !
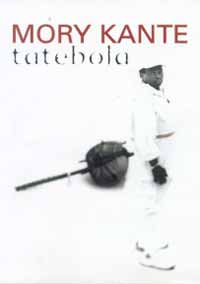 En
1971, Mory a 21 ans. Il est repéré par le saxophoniste
Tidiane Koné qui lui propose d'intégrer
son groupe, le Rail Band
de Bamako, fameux orchestre de l'hôtel de la gare. Mory accepte
et prend place dans l'orchestre dont le chanteur n'était autre
que Salif Kéita.
En
1971, Mory a 21 ans. Il est repéré par le saxophoniste
Tidiane Koné qui lui propose d'intégrer
son groupe, le Rail Band
de Bamako, fameux orchestre de l'hôtel de la gare. Mory accepte
et prend place dans l'orchestre dont le chanteur n'était autre
que Salif Kéita.
Lorsque ce dernier quitte le groupe en 73, Mory
Kanté le remplace au chant. D'abord hésitant,
il prend très vite goût à ce nouveau rôle.
La formation tourne dans toute l'Afrique de l'Ouest où l'apprenti
devient un artiste connu. En 1976, il reçoit le Trophée
de la "Voix d'or" au Nigeria. Parallèlement, il apprend
la kora et transgresse
ainsi une certaine tradition qui veut que le balafon
soit l'instrument noble dans sa famille. Il devient cependant très
vite un virtuose de cette harpe à 21 cordes.
"Toute
ma démarche depuis le départ a été de
tendre vers la communication inter-culturelle et de positionner les
instruments africains dans l'arbre de la musique universelle. Cela
a marché. Maintenant tout le monde connaît le balafon
ou la kora, qui
sont parfois intégrés dans des groupes pratiquant une
musique de fusion. Aujourd'hui la musique traditionnelle africaine
est reconnue et appréciée dans le monde, alors pour
moi, le but est atteint", explique Mory. Il exerce également
ses talents de compositeur en écrivant des musiques pour des
chœurs et des ballets. Enfin, il enregistre avec le Rail
Band, une longue épopée dans la plus pure tradition
des griots, "L'Exil de
Soundiata, le fondateur de l'empire Mandingue". En 1977, il entreprend
à titre personnel une tournée des grands sites historiques
de l'empire au cours de laquelle il rencontre de nombreux maîtres
de la tradition afin de parfaire son rôle de griot.
En dépit des variations modernes qu'il impose à la tradition
musicale, Mory Kanté ne mettra
jamais de côté son hérédité familiale.
En 1978,
Mory est installé à Abidjan en Côte d'Ivoire,
ville musicalement très active et où les moyens de travailler
et d'enregistrer sont surtout plus nombreux. Le musicien s'éloigne
alors du Rail Band. Il s'entoure
alors d'un nouvel ensemble de musiciens, dont Djeli
Moussa Diawara. Désormais, la kora
est au centre de son travail. De plus en plus, il songe à renouveler
la musique traditionnelle en y insufflant des sons et des rythmes
occidentaux. Le groupe est engagé par un des plus grands restaurants
de la ville qui recherche une façon un peu originale d'animer
ses soirées. L'occasion est excellente pour que Mory
Kanté se lance dans des mélanges musicaux encore
inédits. Aux airs traditionnels, il donne un habillage rock
ou funk, et de la même façon, il revisite les répertoires
Africains-Américains à la kora,
au djembé
ou au bolon (basse
africaine à trois cordes à laquelle Mory en ajoute deux).
Les bases d'un nouveau style sont jetées. Le succès
est immédiat, même si cette modernisation de la musique
traditionnelle n'est pas toujours appréciée par son
entourage et par les puristes. Il n'est pas rare de le voir surnommer
"l'enfant terrible" dans la presse de l'époque.
C'est à Los Angeles, sur le label du noir américain
Gérard Chess Ebony, que Mory Kanté
enregistre son premier disque en 1981, "Courougnègnè".
L'artiste affine ses heureux mélanges entre tradition et modernité,
entre instruments traditionnels et électriques. Déjà
très connu en Afrique de l'Ouest, Mory devient une star sur
tout le continent. Le pont musical qu'il crée entre l'Afrique
et l'occident est en général bien accueilli. Suite à
ce succès, il monte un grand ballet pour le centre Culturel
français d'Abidjan. Sur scène, la formation regroupe
75 artistes : une chorale, des musiciens et des danseurs. Durant les
années qui suivent, Mory se produit régulièrement
avec un
orchestre de presque 20 personnes. Mais, c'est en Europe que le Guinéen
souhaite venir travailler.
 Du
rêve à la réalité.
Du
rêve à la réalité.
Ce désir devient réalité en 1984. Seul, sans
son épouse et ses enfants qui restent à Abidjan, Mory
Kanté arrive en France en plein hiver avec la ferme
intention d'aller plus loin encore dans ses expériences musicales
et de se faire connaître en Europe. En France, Mory
Kanté n'est pas une star et le démarrage n'est
pas facile. Cependant, la musique africaine explose en occident au
cours des années 80. C'est la naissance de la world music,
mélange des rythmes traditionnels du monde entier et des sons
modernes, rock, funk, jazz ou électroniques. Mory, qui n'a
pas attendu les années 80 pour se lancer dans ces mélanges,
s'impose vite sur le marché musical.
Dès 1984, sort un premier album "Mory Kanté à
Paris" produit par le producteur africain Aboudou
Lassissi. L'accueil critique et public est bon et Mory
Kanté se fait connaître en quelques mois. Il multiplie
les concerts dans toute l'Europe, dont en Italie où il devient
une grande vedette. Artiste émigré et sans carte de
séjour, il devient une figure essentielle de la scène
"World". Mutualité, New Morning, Bercy, et autres
scènes de prestigieux festivals vont lui permettre de consolider
ce succès. En 1985, Le camerounais Manu
Dibango prend l'initiative d'inviter les artistes africains
à enregistrer une chanson au profit des éthiopiens,
victimes de la famine qui sévit alors. Mory
Kanté fait naturellement partie du projet.
C'est en Italie, qu'il fait la connaissance du producteur américain
David Sancious, qui s'est illustré
en travaillant avec Bruce Springsteen.
Le mariage de leurs deux talents donne naissance à un troisième
album, "Ten Cola Nuts" qui sort en avril 1986 sur le label
français Barclay. Ces noix de cola représentent des
offrandes rituelles et des vœux de bonheur. La kora
est toujours au centre de l'album, mais les synthétiseurs et
les cuivres viennent enrichir l'ensemble. Le travail est très
soigné et salué par la presse comme une sublime réussite.
Les scores de ventes sont moyens mais cette fois, Mory
Kanté a réellement trouvé un équilibre
musical et culturel.
Juste après la mort de son père, à plus de cent
ans, le jeune griot guinéen entame une très longue tournée
avec un premier concert au Zénith de Paris le 29 mai. En juin,
il fait un passage en Côte d'Ivoire et au Sénégal
où il participe à un rassemblement anti-apartheid organisé
le 14 juin, sur l'île de Gorée, l'île aux esclaves,
au large de Dakar. S'ensuivent des tournées en Europe, aux
Etats-Unis et un peu partout dans le monde (Japon, Australie...).
Avec un groupe qui, à l'image de sa musique, profondément
métissé parce que composé de Maliens, Sénégalais,
Sud Africains, Français, Américains, Anglais, Suédois
qui partagent leurs cultures et leurs expériences.
Griot électrique
Celui qu'on surnomme désormais "le griot électrique"
atteint l'année suivante, en 1987, les sommets du succès
avec son nouvel album "Akwaba Beach". Enregistré
avec la collaboration du producteur anglais Nick Patrick, sous l'œil
bienveillant et complice du président de Barclay, Philippe
Constantin. Ce disque marque le triomphe du funk mandingue grâce
un titre particulier, "Yéké Yéké"
qui explose les hit-parades du monde entier. A commencer par les Pays-Bas.
Composé au début des années 80, le titre se trouvait
déjà sur l'album "Mory Kanté à Paris".
Mais, non satisfait de cette première version, il décide
de le remixer. Jackpot ! Le titre devient un succès exceptionnel
sur lequel des publics du monde entier vont danser. En quelques années,
le 45 Tours atteint des scores de vente chiffrés en millions
d'exemplaires et fait l'objet d'innombrables transformation, adaptations
et reprises en hébreu, arabe, chinois, hindi, portugais, anglais
ou espagnol. Avec "Yéké Yéké",
Mory Kanté devient l'artiste africain
le plus vendu et peut-être le plus connu à travers le
monde. En juillet 88, le titre "Yéké Yéké"
atteint la première place du classement pan-européen
établi par le fameux hebdomadaire professionnel américain,
"Billboard". Juste après avoir reçu un disque
d'or en octobre 88 en France, Mory Kanté
est récompensé en novembre à Paris par la Victoire
de la Musique du meilleur album francophone.
En janvier 1990, il retrouve les studios à Bruxelles, puis
à Los Angeles, pour mettre au point son album "Touma"
("Le moment"). Pour l'occasion, et fort de sa notoriété,
il s'entoure de grands noms dont le guitariste chicano-américain
Carlos Santana (très connu en
Afrique) ou le Sud-africain, Ray Phiri.
La démarche est la même que pour "Akwaba Beach"
et développe un mélange subtil et sophistiqué
entre pop et tradition mandingue. L'album sort en septembre 1990.
Souffrant et bénéficiant à la fois du succès
géant de l'album précédent, les ventes ne dépassent
guère le disque d'or en France et atteint à peine le
million à l'étranger.
Le 14 juillet 1990, il représente la France avec Khaled
lors d'un concert géant à New York, dans Central Park,
devant des milliers de new-yorkais. En novembre, toujours à
New York, il participe au Gala de la francophonie dans le célèbre
Apollo Théâtre de Harlem qui a vu débuter son
idole, James Brown.

En ce début des années 90, Mory
Kanté songe sérieusement à revenir plus
souvent sur sa terre natale. Comme le noble malien Salif
Kéita, le griot guinéen souhaite utiliser son
nom et ses moyens financiers pour aider ses compatriotes, et en particulier
les plus jeunes. C'est ainsi qu'il projette de monter à Conakry
un complexe culturel du nom de Nongo Village comprenant entre autres
un studio, un centre de formation aux métiers du spectacle,
un hôtel et un musée des griots. Dans un Mali en crise,
le projet aura du mal à voir le jour. D'autre part, il réalise
un autre de ses nombreux projets, avec la création d'un orchestre
philharmonique d'une trentaine de koras, et autant de harpes, violons
et flûtes. C'est avec cet Ensemble Traditionnel de Guinée
de 130 musiciens qu'il se produit en 1991 pour l'inauguration de la
Grande Arche de la Défense à Paris.
C'est chez lui en Guinée que la star de l'afro-dance enregistre
son nouvel album "Nongo Village" du nom de son studio. Parmi
les onze titres mixés à New York et à Paris,
c'est "La Tension" qui semble destiné à conquérir
les foules et à envahir les pistes de danse dans la même
lignée que "Yéké Yéké".
Dans ce disque, Mory Kanté réintègre
le balafon qui détrône les guitares. Le premier extrait
sort en septembre 93 suivi de l'album à l'automne. L'accueil
est moyen, et certains lui reprochent de se perdre un peu dans une
recette qui manque de renouvellement. Mais, en 1994, Mory Kanté
reçoit le "Griot d'Or".
Après toutes ces années de succès, Mory
Kanté choisit de retrouver une musique plus familiale,
plus traditionnelle. Peut-être un peu las de son image de "griot
électrique", le Guinéen se tourne vers ses sources
et vers une pratique plus authentique de son art et de son métier.
La part des choses
En 1996, Mory Kanté sort un album
autoproduit. En effet, l'album "Tatebola" ("la part
des choses") se met à l'heure de la techno. Mais les bases
rythmiques de la techno ne sont peut-être pas si éloignées
des percussions ancestrales et les inspirations musicales de ce disque
se veulent proches des origines mandingues. L'artiste a autoproduit
ce dernier disque afin de conserver une certaine indépendance
de création. C'est en juin 2001 qu'il sort "Tamala"
(le Voyageur) après un long silence. Agé de 51 ans,
le musicien n'a pourtant cessé de tourner à travers
le monde mais sans guère d'escale française. Cette fois,
on le retrouve avec un album dans l'afro funk mandingue qui a fait
son succès il y a 15 ans. La part d'instruments traditionnels
est importante et donne une saveur plus douce et moins électronique
à l'ensemble. C'est l'Anglais Paul Borg
qui produit le disque sur lequel on trouve toujours de nombreuses
influences, hip hop, gitane ou soul via un duo avec la diva du rythm
and blues britannique, Shola Ama.
"Tamala résume ma vie car j'ai beaucoup voyagé.
Le griot voyage toujours. Qu'il se déplace d'un village à
l'autre, de sous-région en sous-région, de pays en pays,
c'est un communicateur, un informateur. Le mot "griot" est
la traduction en français du terme mandingue "jali",
qui signifie en fait "le sang" circulant dans notre corps
qu'il connaît donc parfaitement. Le jali est effectivement celui
qui connaît le mieux notre société mandingue.
Il en perpétue les réalités historiques, culturelles
et économiques", expliquait-il dans une interview
accordée à RFI. Pour lui, malgré les mutations
socio-culturelles, "les pays mandingues sont vraiment attachés
à leur culture et à leur civilisation et ont toujours
accordé une place privilégiée aux griots. Aujourd'hui
encore au Mali, les griots sont consultés à l'Assemblée
Nationale et en Guinée également pour tout ce qui concerne
les grandes décisions. On sait que ce sont eux qui sauvegardent
la mémoire du passé et celle du présent. Ils
ont également leur place dans les grands mariages coutumiers.
Ils ne sont pas des profiteurs comme on l'a entendu dire parfois,
leur but n'a jamais été de s'enrichir sur le dos des
gens".
De toute sa carrière, c'est apparemment le succès phénoménal
de Yéké Yéké qui l'a le plus marqué.
Il aime rappeler, "Yéké Yéké
continue à marcher encore aujourd'hui, ce qui évidemment
me satisfait. Leonardo di Caprio en a utilisé un remix pour
la bande originale de son film The Beach. Mais je n'ai pas fait uniquement
cela et Yéké Yéké n'illustre que l'un
des aspects de ma démarche qui est la valorisation des instruments
traditionnels. C'est cela mon vrai but et ce que je vise encore à
travers Tamala, mon nouvel album, en construisant un pont entre la
tradition, la musique authentique et le monde moderne".
King Moseto
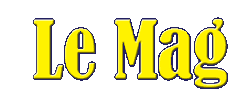
 MORY
KANTE ARTISTE
MORY
KANTE ARTISTE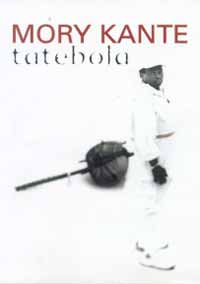 En
1971, Mory a 21 ans. Il est repéré par le saxophoniste
Tidiane Koné qui lui propose d'intégrer
son groupe, le
En
1971, Mory a 21 ans. Il est repéré par le saxophoniste
Tidiane Koné qui lui propose d'intégrer
son groupe, le  Du
rêve à la réalité.
Du
rêve à la réalité.